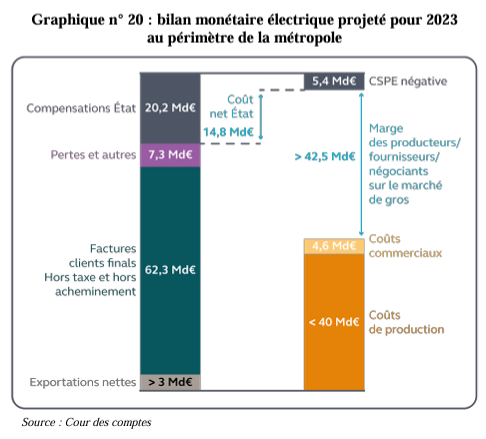Article du Figaro en 2019
Par Claudia Cohen
Publié le 24/07/2019 mis à jour le 25/07/2019
En 2014, la branche énergie du groupe Alstom est rachetée par l’américain General Electric. Cinq ans plus tard, cette cession continue de faire couler beaucoup d’encre. Le parquet national financier, notamment, a récemment indiqué s’être saisi de l’affaire après qu’un député a émis des soupçons quant à un potentiel «pacte de corruption» impliquant Emmanuel Macron.
Une enquête préliminaire ouverte, plusieurs plaintes déposées et un thriller politico-
industriel qui revient sur le devant de la scène. Hasard du calendrier ou concertation
entre les différents acteurs, le dossier ô combien épineux du rachat de la branche
énergie d’Alstom par General Electric en 2014 fait de nouveau polémique depuis
quelques jours. Cette transaction, de près de 13 milliards d’euros, était – et est toujours –
qualifiée par ses opposants de «scandale d’État», celle-ci revenant, entre autres, à
confier à un groupe étranger la maintenance des turbines des 58 réacteurs nucléaires français.
La semaine dernière, le Parquet national financier (PNF) a confirmé avoir pris le
relais du parquet de Paris, saisi en janvier 2019 par le député LR Olivier Marleix pour
enquêter sur les circonstances de la vente. Dans le cadre de la commission d’enquête
sur «les décisions de l’État en matière de politique industrielle», qui englobe la
cession d’Alstom, créée en 2017, l’élu d’Eure-et-Loir avait mené une série d’auditions pour comprendre le contexte et les conditions de la cession d’Alstom Énergie à General Electric. Il en est venu à soupçonner un «pacte de corruption» qui aurait pu bénéficier à Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie au moment de la signature de la vente, dans le cadre de sa campagne pour la présidence de la République.
L’enquête du PNF intervient dans un contexte particulièrement sensible, puisque
l’intersyndicale de GE a mis en demeure jeudi 18 juillet le gouvernement de faire
respecter par le groupe américain son engagement de préserver l’emploi. Or General Electric a amorcé un vaste plan social devant conduire à la suppression de 1050 postes, bien loin des 1000 emplois qu’il avait promis, en novembre 2014, de créer d’ici fin 2018.
En outre, dès le lendemain, des employés de General Electric à Belfort ont lancé
une procédure de signalement de «danger grave et imminent» pour les salariés du
groupe, pointant le décès de trois d’entre eux en trois semaines, a appris l’AFP de source syndicale.
Parallèlement, lors d’un dîner à Belfort avec l’intersyndicale fin juin, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l’Économie de François Hollande, a appelé le
gouvernement à «annuler» la vente qu’il qualifie «d’erreur majeure». Une
recommandation qu’il a réitérée jeudi 11 juillet au palais du Luxembourg lors d’une
audition par des sénateurs, tout en accusant Patrick Kron, ancien PDG du groupe Alstom,
d’avoir «trahi son pays». De son côté, l’ONG française Anticor a déposé lundi 22 juillet
une plainte pour «corruption» et «détournement de fonds publics» auprès du pôle financier du tribunal de Paris.
Ces derniers rebondissements, qui portent sur des aspects très différents les uns des
autres, viennent rappeler la profonde complexité de l’affaire Alstom-General Electric.
Voici ce qu’il faut savoir pour comprendre les crispations encore vives autour de ce
dossier.
La vente controversée d’un fleuron de l’industrie française, sous le ministère de Macron
En avril 2014, l’annonce par Bloomberg de discussions entre General Electric et Alstom
pour le rachat du pôle Energie de ce dernier fait grand bruit. D’une part, le fleuron
industriel français dément immédiatement être au courant d’une possible offre publique d’achat, alors que l’agence de presse économique affirme que des négociations ont bien été entamées, d’autre part, l’exécutif assure ne pas avoir été mis au courant de ce projet d’acquisition d’une partie d’une entreprise que l’État avait sauvée de la faillite dix ans plus tôt, via la montée au capital de Martin Bouygues à la demande de Nicolas Sarkozy.
« Des prestataires qui ont été rémunérés grâce à la vente d’Alstom Power
figuraient parmi les donateurs de la campagne d’Emmanuel Macron »
Olivier Marleix, députe LR en charge de la commission d’enquête
Pourtant, quelques mois plus tôt, en janvier 2014, le ministre de l’Économie Arnaud
Montebourg «apprend aux détours d’un couloir la possibilité d’un accord passé, entre Alstom et l’américain, par la présidente de GE France. Il convoque alors Patrick Kron, qui l’assure que le groupe n’a aucunement l’intention de vendre le pôle énergie et nie en bloc l’information. En avril, la possibilité d’une vente est annoncée, et Montebourg se retrouve désemparé», raconte Olivier Marleix au Figaro. Le défenseur du Made in France tente alors de trouver une alliance européenne avec Siemens et dégaine
surtout un décret visant à bloquer la vente. Ledit décret repose sur l’article L151-3 du
code monétaire et financier indiquant que des entreprises jugées utiles aux intérêts
nationaux ne peuvent être vendues sans une autorisation administrative du ministre de l’Économie. Mais ses efforts sont contrecarrés par son départ du gouvernement en août.
Trois mois plus tard, le 4 novembre 2014, Emmanuel Macron, devenu ministre de
l’Économie, donne son accord à la vente et la présente comme une «alliance industrielle». Le 19 décembre 2014, l’Assemblée générale d’Alstom valide le rachat de la branche Énergie par GE.
Dès cette époque les opposants à la vente soupçonnent que si Arnaud Montebourg se
trouvait dans l’ignorance des préparatifs, c’est parce que Patrick Kron s’était assuré des préparatifs de la vente directement au plus haut niveau de l’État ou auprès d’autres ministres. «Par élimination, nous avons conclu qu’Emmanuel Macron, à l’époque secrétaire général adjoint de l’Élysée, avait commandé en 2012 une étude à l’Agence des participations de l’État sur les conséquences d’une éventuelle vente, dans le dos de ministère de l’Économie. Il connaissait la possibilité de la vente, et n’a pas pris la peine d’élaborer un scénario qui aurait permis de sauver Alstom», affirme le député. En avril 2015, Emmanuel Macron, convoqué par la Commission des affaires économique dans le cadre de l’enquête, dément avoir eu connaissance au préalable du projet de cession.
Dans sa lettre de janvier au procureur, qui a conduit à l’ouverture de l’enquête confiée
désormais au PNF, Olivier Marleix émet l’hypothèse d’un possible «pacte de corruption» au bénéfice d’Emmanuel Macron. «Si j’en crois la presse et d’autres interlocuteurs, des personnes qui avaient à l’époque intérêt à la vente, tels que les intermédiaires financiers, et qui ont été rémunérés en termes de success fees («rémunération au succès») grâce au deal, figuraient parmi les donateurs et organisateurs de levées de fonds pour la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron», affirme-t-il au Figaro.
Avec l’enquête du PNF, le député espère «une évaluation sérieuse du financement de la campagne de Macron».
La guerre économique, sur fond de corruption
Mais les ramifications de l’affaire ne s’arrêtent pas là. Fin 2013, soit quelques mois avant la vente d’Alstom Power, l’entreprise reconnaît auprès de la justice américaine des faits de corruption commis par des officiels en Arabie saoudite, Indonésie, Egypte, ou encore à Tawaïn, entre 2000 et 2011. Des enveloppes de cash servaient à s’assurer que le groupe remporte des contrats importants à l’international. À l’issue de ce procès, Alstom
doit payer une amende de 772 millions de dollars. Et alors qu’il était prévu, dans les
modalités de la vente avec GE, que l’américain s’en acquitte, c’est finalement le français qui, à l’arrivée, paiera l’addition. Autre conséquence des aveux de corruption, plusieurs dirigeants d’Alstom se font arrêter aux États-Unis, et certains se retrouvent même incarcérés.
À l’époque, Alstom fini par payer l’amende de 772 millions de dollars, imposée par la justice américaine, alors que le deal entre Alstom Power et GE stipulait que l’américain s’en acquitte.
Plusieurs ex-cadres d’Alstom soupçonnent les États-Unis d’avoir ouvert, dès 2010,
une enquête pour corruption à l’encontre de l’industriel français dans le seul but de
s’en emparer. L’ex-PDG Patrick Kron, qui défendait en avril 2014 la proposition de
GE, a toujours démenti cette version des faits : la vente d’Alstom Power n’a en rien été précipitée par les poursuites judiciaires américaines, ni par la menace d’une
quelconque inculpation. Dans les colonnes du Figaro en juin dernier, Patrick Kron
affirme que la vente «fut une bonne décision pour Alstom et pour la France», et
justifie la cession par un nécessaire sauvetage économique dans «l’intérêt social de l’entreprise». Après la vente d’Alstom Power, l’ancien PDG part de l’entreprise fin 2015 avec un bonus de 4 millions d’euros en plus de sa retraite chapeau de 10
millions d’euros, ce qui n’a pas manqué de lui attirer des critiques de tous bords.
Parmi les documents révélés par Edward Snowden en 2015 dans les cadre des
WikiLeaks, certains prouvent que l’espionnage économique des entreprises françaises par les agences de renseignement américaines est chose commune. La justice
américaine compte même sur la NSA pour réunir des informations sur des contrats
aux montants faramineux. En janvier 2019, dans son livre Le piège américain, un
ancien dirigeant d’Alstom incarcéré deux ans outre-Atlantique affirme même
que GE avait fait pression sur l’équipe dirigeante pour l’obliger à vendre l’entreprise.
Ancien président de la filiale chaudières d’Alstom, Frédéric Pierucci avait été arrêté
en 2013 aux États-Unis pour une affaire de corruption en Indonésie. Selon lui, les
poursuites américaines visaient bien à décomposer Alstom et à faire chanter ses
dirigeants, dont Patrick Kron, directement menacé à titre personnel. Ce dernier ne
s’est pas rendu aux États-Unis, échappant ainsi à une éventuelle incarcération.
À l’instar de la lettre du député Marleix au procureur, le premier volet de la plainte
d’Anticor déposée lundi vise à ce que la justice française enquête également sur les
faits de corruption reconnus par Alstom auprès de la justice américaine, ainsi que sur les responsabilités éventuelles des dirigeants.